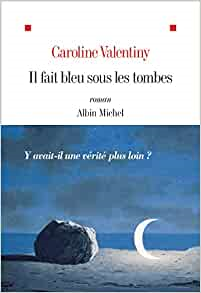Suite à de nombreux traumatismes, notamment des abus sexuels, j’ai commencé à l’âge de 13/14 ans à me dissocier très fort et à me replier sur moi même. Avant cette période, je n’étais pas une enfant très sociable mais lorsque la dépression et le PTSD ont commencé à s’installer, tout a empiré.
J’investissais en revanche une forme de monde intérieur pour fuir le réel (que je ne comprenais même pas). De toute façon, j’avais l’impression que ce « dehors », là, n’existait pas. Lorsque je regardais ma main, ce n’était pas « ma » main, c’était un carré de peau rempli pourvu de traits verticaux qui se mouvaient tous seuls. Je marchais au dessus de mon corps. Parfois, je marchais en apesanteur. Mes capacités d’attention ont commencé à être affectées et lorsque je parlais aux adultes de ce qui m’arrivait, parce que ça me terrorisait, on me disait que j’inventais et que j’avais trouvé tout ça sur internet.
J’ai fini par m’habituer à cette idée que rien n’existait, ni mon corps ni le monde, et qu’après tout j’avais bien mes bouquins, ma musique, mon monde à moi.
Est arrivé le procès et le psychiatre. Mon premier bon psychiatre et une adorable psychologue aussi, à qui j’ai pu parler de mes traumatismes pour la première fois. Anti dépresseurs, benzodiazépines. Suivi psychomoteur pour la dissociation. Vers mes 17 ans, j’ai commencé à aller mieux, la dissociation diminuait et je reprenais l’école suite à une année de déscolarisation à cause d’évitement social et des effets secondaires du traitement. J’ai commencé à reprendre espoir : les mauvaises personnes étaient loin de moi grâce à la justice, je me sentais de nouveau « là », « vivante » et j’avais envie de faire des études. Mais un nouveau problème a commencé à émerger : si la dissociation était de moins en moins forte la plupart du temps, j’avais des périodes où elle revenait en force d’un seul coup jusqu’à ce que je commence à faire des crises d’angoisse étranges…
Durant ces crises d’angoisse, j’avais l’impression d’être submergée par une terreur sans nom. Le monde s’effondrait. Ma tête s’effondrait. Je cessais d’exister et j’éclatais de partout en même temps : je me sentais enfermée dans ma tête tandis qu’elle explosait, tandis que « mon esprit » éclatait en morceaux qui eux, partaient dans l’espace. J’avais l’impression, aussi, que mon corps était coupé et que j’avais perdu des membres ou des bouts quelque part. Ces crises duraient quelque heures et me laissais épuisée pendant des semaines, des semaines où je ne voulais parler à personne, où j’avais peur de chaque chose qui bouge, où le danger était partout. Je ne pouvais pas expliquer ça. J’avais honte, j’étais incapable de mettre les mots là dessus et de toute façon je vivais avec la peur de tout inventer pour demander de l’attention, d’être un gouffre vide et sale qui ne mérite pas qu’on fasse attention à sa pseudo-souffrance.
Les crises sont devenues de plus en plus fortes et fréquentes. J’avançais vers mes 18 ans à cette période et si j’arrivais enfin à mettre les mots sur des émotions aussi fortes, j’avais toujours autant peur d’en parler. J’avais peur aussi d’avoir un cerveau cassé par les gens qui m’avaient fait du mal, comme si je portais la saleté qu’ils avaient déposé sur moi.
Mais de bonnes nouvelles sont arrivées. Mes petites sœurs ont commencé à aller mieux et j’ai eu de vrais amis. De vrais amis, ça veut dire des gens avec qui j’avais le droit d’être vulnérable en toute sécurité et c’était nouveau pour moi. J’ai réussi à leur parler de tout ce que j’avais en moi et j’ai été accueillie, ça m’a fait un bien fou. Les crises ont alors diminué même si les symptômes du traumatisme étaient encore compliqués à gérer pour moi. J’ai réussi à me stabiliser et à arrêter les antidépresseurs. Mes psys ont commencé à se questionner sur l’origine de ces crises avant de conclure qu’il s’agissait d’angoisses archaïques de morcellement.
Aujourd’hui j’ai 19 ans et je m’en sors. J’ai toujours des crises qui me détruisent mais je commence à comprendre doucement comment ça fonctionne et à guérir mes blessures. Les psys ne m’ont jamais diagnostiquée psychotique et on a gardé l’idée des angoisses archaïques. Par ailleurs ces dernières ont évolué. Par exemple, la dernière fois que c’est arrivé, c’était pendant la nuit. C’est monté, monté pendant des heures. Au début, je me sentais simplement sale, puis après j’ai eu l’impression d’être couverte d’une substance visqueuse. Puis j’ai commencé à sentir que je pourrissais de l’intérieur, littéralement. Une sorte de nécrose qui me rongeait les organes. J’étais terrorisée et je ne pouvais rien faire pour empêcher ça. Quand le monde a commencé à pourrir aussi et que j’avais du mal à respirer, j’ai réveillé quelqu’un et j’ai fait un malaise.
De même, par exemple, j’ai toujours du mal avec la foule et les grands espaces. Ce regard des autres qui m’envahit, me transperce, rentre à l’intérieur de ma tête. D’une part, dans de si grands espaces, je ne sais pas où placer mon corps, mais la foule fait que j’ai l’impression que les corps des autres perdent le mien dans un amas grouillant et terrorisant. Ils envahissent ma tête, mon corps, je suis submergée et je tétanise.
Aujourd’hui je vais mieux en grande partie grâce à mon entourage mais aussi parce que j’arrive à relever les éléments déclencheurs et à comprendre que j’ai besoin de douceur vis à vis de moi même. J’ai une vie très ritualisée et dès que je sors de chez moi, dès que je perds les habitudes qui me permettent de trouver des repères avec mon corps et le monde, comme le sport, ma chambre ou mes rituels, la crise n’est pas très loin si je ne parviens pas à compenser. Trop d’agitation ou d’anxiété, trop d’espace, pas assez de contenance sont aussi des déclencheurs. De même, lorsque je commence à avoir des idées un peu « étranges » (même si dans ma tête elles sont tout à fait logiques), comme par exemple l’impression que la pourriture dans la rue ou sur les aliments sont une forme de corruption du monde, c’est que ça ne tourne pas rond. Depuis que j’ai compris tout ça, j’ai commencé à déculpabiliser : non Aëolienne, tu ne fais pas semblant, tu es juste traumatisée et tu as besoin de douceur, maintenant.